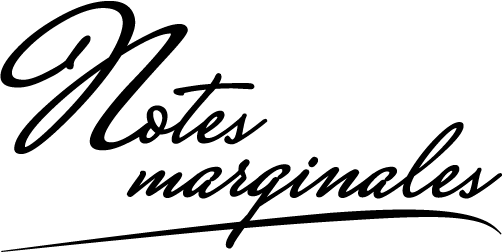Un jour, Neil Gaiman a paraphrasé l’auteur G. K. Chesterton* et, possiblement parce que le moderne l’emporte souvent sur l’ancien, la citation a été attribuée à l’auteur de Coraline plutôt qu’au créateur du père Brown. Sous sa forme la plus récente, la sage parole va comme suit: « Les contes de fées sont plus que vrais: pas parce qu’ils nous disent que les dragons existent, mais parce qu’ils nous disent qu’ils peuvent être vaincus. » Et maintenant, il s’avère que Neil Gaiman était, tout ce temps, lui-même un dragon.
En effet, panique et consternation dans le grand monde des Lettres alors que la journaliste Lila Shapiro rapportait dans New York Magazine les nouvelles accusations portées contre Neil Gaiman de la part de quatre femmes, portant maintenant à huit le nombre d’accusatrices depuis les premières révélations à l’été 2024. Consentement bafoué, pratiques dégradantes, sadisme et manipulation — le récit des victimes a de quoi chavirer à la fois le coeur et l’estomac des âmes les plus aguerries. C’est un portrait en négatif ahurissant d’un auteur qui, jusqu’à maintenant, se présentait comme le chantre du féminisme, l’idéal masculin de l’allié de la femme, un parangon de sensibilité.
Je laisse aux autorités compétentes le soin de démêler cette affaire sur le plan légal. Tout ce que je peux faire pour l’instant, c’est, selon les dires mêmes de l’accusé dans un tweet de septembre 2018 qui a très mal vieilli, « croire les survivantes ».
Pour l’heure, je veux me saisir d’une autre question, une que je vois en filigrane de nombreux commentaires sur cette affaire: peut-on départager l’œuvre de l’artiste?
C’est une question qui revient toutes les fois que des révélations sont faites au sujet d’un artiste dont le comportement s’avère répréhensible: comment peut-on continuer d’apprécier une œuvre lorsqu’on sait que la personne qui en est l’auteure est un monstre?
À cela, je réponds: pourquoi faudrait-il même avoir un jugement sur l’auteur?
Il fut un temps où l’auteur entrait peu en ligne de compte lorsque l’on consommait — je déteste ce terme — de l’art. L’auteur, c’était un nom sur une jaquette, une photo sur une quatrième de couverture, une rencontre fugace lors d’une séance de dédicace. Peut-être pouvait-on découvrir sa pensée hors de l’œuvre, livrée au cours d’une rare entrevue. Hormis cela, l’auteur demeurait une lointaine réalité. Au mieux, il constituait une étiquette facile d’utilisation pour repérer — ou éviter! — des œuvres similaires à celles qui nous avaient déjà marqués.
Or, à notre époque de saturation médiatique, l’auteur est devenu une œuvre, voire un produit, en soi. C’est lui que l’on met de l’avant dans le battage publicitaire qui entoure la sortie d’un livre. On voit de moins en moins de critiques littéraires discuter d’un roman sur un plateau de télé et de plus en plus d’auteurs être conviés à leur place aux émissions de fin de soirée.
De plus, la prolifération des réseaux sociaux et leur utilisation à outrance par tout un chacun a lentement mais assurément érodé la notion de personne privée. Maintenant, l’auteur est parmi nous: il partage ses humeurs, échange avec ses collègues et ses fans, souhaite la bonne année, etc. Ce contact, en toutes apparences constant et en temps réel, a achevé d’effacer la barrière qui faisait de l’auteur une distante préoccupation, exacerbant ainsi au plus haut point l’aspect parasocial de notre relation avec lui. L’auteur est désormais un proche.
Or, ce qui nous est donné de voir d’une personnalité publique, la partie visible de l’iceberg que constitue une personne complète, c’est une image savamment étudiée et contrôlée, dont la vocation est de créer cet attachement parasocial favorable à un succès financier.
Alors pourquoi donc aimer l’auteur? Cela me semble maintenant futile de s’enticher du rôle joué par quelqu’un sur la scène de l’industrie du divertissement. Cet amour de l’auteur et toutes les « obligations » que cet amour a créées pour lui envers nous, tout cela n’est que le produit utilitaire d’un effort purement publicitaire.
L’œuvre elle-même n’a pas besoin de l’auteur pour être aimée, ergo l’auteur n’a pas besoin d’être aimable.
Qui plus est, l’œuvre seule est digne de confiance puisque c’est une manifestation tangible, une conséquence palpable de la seule chose qui compte: le talent. Le reste n’est qu’une profession de foi, au mieux imprécise, au pire trompeuse.
Ainsi, il est possible d’admirer l’œuvre d’un monstre tout en haïssant le monstre lui- même. C’est ce qu’ont fait pendant des années les critiques, les chercheurs et même les simples lecteurs: apprécier un ouvrage, mais en comprenant son contexte. Peut-être aurions-nous besoin de cette approche plus froide, plus académique en fait, plutôt que de déchirer nos chemises toutes les fois qu’une vedette littéraire trahit nos attentes de groupies.
Cela dit, si l’on continue de reconnaître le talent d’un auteur malgré ses crimes, ça ne signifie pas qu’il faille lui permettre de tirer profit de son œuvre. Pour les producteurs de cinéma et de télévision, ça signifie stopper les projets et renégocier les contrats. Pour les maisons d’édition, ça signifie arrêter d’imprimer et de distribuer les livres.
Et pour le simple lecteur? C’est accepter la fin de l’époque où l’on admirait, à tort, autant l’homme que l’œuvre. Concrètement, il faut arrêter d’acheter et de recommander. On doit aux victimes de laisser mourir l’homme dans l’opprobre qu’il s’est mérité et garder l’espoir que les mots qui nous sont restés conservent au moins la valeur littéraire qui leur revient à eux seuls, à juste titre.
Ne croyez pas que je me permets de prêcher comme « celui qui a toujours su ». Cette leçon, je viens de l’apprendre. Je l’ai digérée dans les derniers jours, je l’ai distillée dans le texte que vous lisez en ce moment.
Elle n’est pas non plus le fruit d’une récente épiphanie. Il y a quelques années, j’ai eu le même choc quand les actes d’un de mes auteurs préférés, Warren Ellis, ont été révélés au grand jour. Je sais aussi très pertinemment que je dois me détacher de l’idée que je me fais d’autres auteurs que j’aime, comme Philippe Claudel, Keigo Higashino, Chuck Wendig, Frédéric Lenormand ou China Miéville. Ce ne sera certainement pas facile de continuer à faire preuve de la belle objectivité que j’ai étalée dans cet article, mais ce sera certainement moins difficile que ce que les victimes de Neil Gaiman ont dû endurer.
Une chose est certaine: tout cela n’enlève rien au fait que oui, les contes de fées nous apprennent effectivement que les dragons peuvent être vaincus. Il faut seulement continuer de croire que cette leçon reste valable, même si elle vient de la gueule du dragon lui-même.
L’important, c’est qu’il soit vaincu à la fin.
* La citation originale est: « Les contes de fées ne donnent pas à l’enfant sa première idée du monstre. Ce que les contes de fées donnent à l’enfant, c’est sa première idée claire de la possible défaite du monstre. »